Flore et faune de la vallée de l'Huveaune
Roquevaire - Carrière Saint-Vincent - (+ d'infos - Fossilisation)
Fossilisation
(d'après le mémoire de DEA de T. Otto.)
Si l'on représente le barrage travertineux en aval du lac, on distingue deux zones où la fossilisation s'opére.

Les vasques : Les feuilles ont la particularité d'avoir pu tourner dans un volume agité de tourbillons, ce qui
a entraîné un encroûtement indifférencié sur les deux faces.
Les faciès à lamines parallèles : une feuille plaquée contre le substrat dans une zone à dépôts laminés reste
plaquée contre celui-ci, et ce, malgré un fort courant d'eau (micro-milieux dans le shéma ci-dessus).
Les fossiles des vasques sont totalement encroûtés, ce qui rend l'examen de certains critères impossible :
- la marge ne peut être observée dans le détail (de petites dents ne seraient pas visibles),
- la nervation est presque entièrement invisible.

Oui, c'est vrai, mais il y a d'autres avantages : je n'ai que très rarement vu une empreinte de feuille de grande taille entière, sûrement pas d'aiguille de pin non plus, pas plus de fruits ou de graines.
Mais, et surtout, vous avez eu l'occasion de le voir dans les pages qui traitent de la flore, quelle beauté !
Cependant il est indéniable que les empreintes des feuilles qui se sont déposées "à plat" sont mieux conservées en terme de détermination.
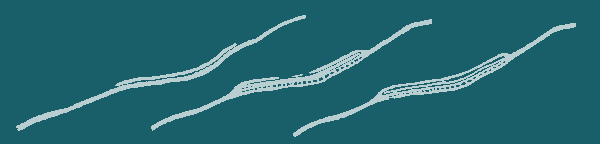
De gauche à droite les trois étapes de ce mode de fossilisation.
- Une feuille se dépose, le voile algaire situé sous la feuille meurt.
- Le voile algaire situé autour de la feuille colonise ce milieu vierge.
- La feuille entre alors en voie de fossilisation.
Ce processus se répétant on obtient des blocs à l'intérieur desquels on trouve une accumulation d'empreintes se superposant.

