Flore et faune de la vallée de l'Huveaune
Roquevaire - Carrière Saint-Vincent - (Conclusions)
Conclusions (suite)...
La Faune
Dans la faune fossile de Roquevaire les mollusques, avec les ostracodes et les larves de phryganides sont susceptibles d'apporter des éléments permettant de préciser
leur milieu de vie à l'époque de leur disparition.
La rubrique + d'infos, dans un volet "Mollusques", permettra aux plus intéressés de voir en détail le principe de répartition en groupes écologiques et la représentation graphique des associations de mollusques basée sur l'utilisation de spectres.
Cette méthode d'analyse est employée dans les conclusions concernant la faune du mémoire de DEA de T. Otto.
Bonifay Eugène - Molinier René Bulletin M.H.N. Marseille 1955 -
Seules deux espèces sont citées sans être décrites dans cet ouvrage. Il semble que la recherche de faune n'était pas dans les préoccupations des auteurs.
Otto Thierry Mémoire de DEA Marseille 1987 -
L'analyse malacologique (F. Magnin) des travertins de Roquevaire porte sur 5 prélèvements de sédiments meubles (craies, sol colluvial ...), répartis sur l'ensemble de la coupe (prélèvements R1 à R5 de la base vers le sommet). La technique d'extraction est celle proposée par Puissegur, les espèces sont ensuite réparties dans les dix groupes écologiques qu'il a définis.
La rubrique + d'infos, dans un volet "Mollusques", permettra aux plus intéressés de voir en détail le principe de répartition en groupes écologiques et la représentation graphique des associations de mollusques basée sur l'utilisation de spectres.
Cette méthode d'analyse est employée dans les conclusions concernant la faune du mémoire de DEA de T. Otto.
Bonifay Eugène - Molinier René Bulletin M.H.N. Marseille 1955 -
Seules deux espèces sont citées sans être décrites dans cet ouvrage. Il semble que la recherche de faune n'était pas dans les préoccupations des auteurs.
Otto Thierry Mémoire de DEA Marseille 1987 -
L'analyse malacologique (F. Magnin) des travertins de Roquevaire porte sur 5 prélèvements de sédiments meubles (craies, sol colluvial ...), répartis sur l'ensemble de la coupe (prélèvements R1 à R5 de la base vers le sommet). La technique d'extraction est celle proposée par Puissegur, les espèces sont ensuite réparties dans les dix groupes écologiques qu'il a définis.
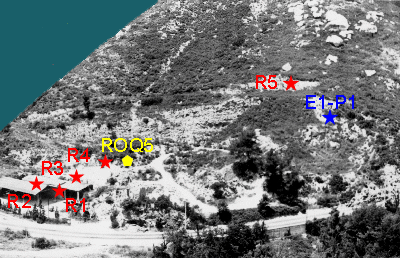
Carrière - Prélèvements.
Malacologiques : étoiles rouges mémoire DEA, étoile bleue l'auteur.
Datation isotopique : en jaune.
Photo T. Otto - 1987.
La photographie ci-dessus nécessite les explications suivantes :
- le cliché a été découpé, la partie manquante en forme de triangle en haut à gauche, ne représente donc pas une pente,
- les prélèvements R1 et R2 ont été effectués dans les couches qui se trouvent derrière les bâtiments,
La faible richesse spécifique du prélèvement R1 résulte du fait que cette faune est totalement autochtone, et qu'elle correspond à un milieu sans doute peu favorable. Seul l'environnement local (la roselière) est mis en évidence.
Au contraire, les malacofaunes des prélèvements R2 et R3 sont des thanatocénoses rassemblant des coquilles provenant de biocénoses différentes. Elles évoquent des formations végétales encore ouvertes, mais au sein desquelles les espèces ligneuses prennent de l'importance. Parmi les espèces steppiques présentes en R2, il convient de remarquer Trochoidea geyeri. Cette hélicelle, réputée centroeuropéenne, ne se retrouve dans le S-E de la France que dans les pelouses des étages subméditerranéen à subalpin, à partir de 1 000 m environ (F. MAGNIN, travaux en cours). Fossile, elle est fréquente dans le "loess" durancien, mais en Basse-Provence, elle disparaît dès les premiers réchauffements holocènes. La présence de Pomatias elegans confirme cependant que les conditions climatiques ne sont pas excessives. Cette espèce est en effet assez thermophile et ne supporte pas les hivers très rigoureux. Partout en Europe, elle marque les périodes de réchauffement.
Le niveau R4 apparaît ainsi comme un optimum du couvert forestier et du climat : Pomatias elegans représente plus de la moitié des coquilles récoltées. Il est en outre accompagné d'espèces forestières sensibles à la présence d'une litière foliacée. Notons enfin que les quelques hélicelles récoltées à ce niveau sont Candidula unifasciata (forme rugosiuscula), et non plus Trochoidea geyeri comme en R2. Compte tenu de la disparition des espèces forestières et de Pomatias elegans en R5, il est possible d'envisager l'amorce d'une nouvelle péjoration climatique dans la partie supérieure de la coupe.
Ostracodes.
Les prélèvements, dans les niveaux R2 et R3, ont fourni une forme d'ostracodes en quantité suffisante pour permettre une détermination aisée. Sept espèces ont été déterminées. Cette étude permet de souligner un fait important: les dépôts qui renferment ces ostracodes se sont déposés au cours d'une période où le froid était plus intense qu'actuellement, au moins en ce qui concerne la saison hivernale (Herpetocypris reptans).
Conclusions.
La construction des travertins de la coupe Saint-Vincent à Roquevaire correspond à une phase globalement tempérée, sans doute un peu plus fraîche que l'actuel, ayant permis l'installation d'une formation végétale de type forestier ouvert. Il semble que l'amélioration climatique soit progressive depuis la base de la coupe jusqu'à un optimum situé en R4. L'amorce d'une nouvelle péjoration pourrait intervenir au sommet de la coupe. Il convient de rester prudent en raison du petit nombre d'échantillons analysés.
Les dépôts de base se sont effectués durant une période où le froid était plus important qu'aujourd'hui.
Note personnelle.
Larves de phryganidés.
Dans la description détaillée de ces larves que donne G. Planchon, trois informations retiennent l'attention qui, si elles ne permettent pas de se situer dans le temps, apportent les précisions suivantes :
- "J'ai découvert Rhyacophila toficola au commencement de juin 1863. A cette époque, les larves étaient abondantes sur les flancs de la petite cascade de Castries, et leurs tubes s'y montraient en grand nombre".
- "Elles s'en vont évitant les courants d'eau, qui les entraîneraient infailliblement".
- "Les premiers jours de janvier m'ont offert l'occasion de résoudre ce petit problème : le 5, il avait gelé à 12°; je me hâtai d'aller à Castries. Un vaste manteau de glace recouvrait la cascade mais je m’aperçus immédiatement que, à l'abri de cette couche peu conductrice l'eau s'écoulait librement sur les parois et que les tubes étaient par suite dans les conditions normales".
La troisième phrase montre que ces larves sont capables de résister sous une couche de glace du moment que le courant n'est pas freiné. Elles peuvent donc résister à des hivers plus froids que ceux que nous connaissons mais rien ne montre que ce fut le cas dans les zones où l'on retrouve ces tubes.
Essai de synthèse.
Le prélèvement que j'ai pu effectuer, dont l'étude n'est pas terminée et qui ne reflète qu'une situation à un endroit donné, ne saurait être pris en compte pour apporter des conclusions personnelles, d'autant que l'identification des espèces, particulièrement dans les conditions de ce gisement, est affaire de spécialistes.
Il n'y a pas à proprement parler de synthèse à faire puisque la seule étude de la faune de Roquevaire est celle reflétée par le mémoire de DEA reprise ensuite dans le livret-guide d'excursion en Basse-Provence effectuée par les chercheurs de l'A.T.P.-PIREN.

